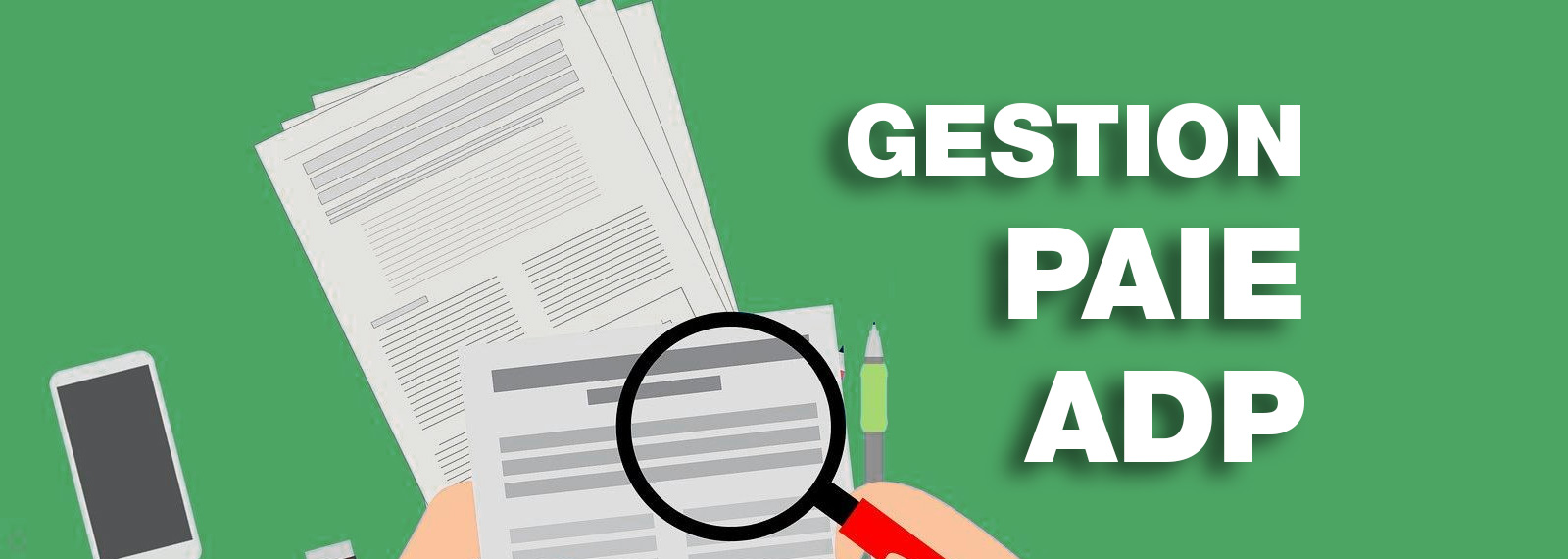1er mai : règles de paie, majoration et obligations
Publié le 02-06-2025

Jour férié à part dans le calendrier français, le 1er mai est encadré par des règles strictes que tout employeur doit connaître : obligation de repos, paiement automatique, et majoration en cas de travail exceptionnel.
Mais au-delà de ses implications pratiques, le 1er mai reste
avant tout une date hautement symbolique. Consacré à la fête du Travail, il
rend hommage aux luttes sociales pour de meilleures conditions de travail.
Depuis la loi du 30 avril 1947, ce jour est inscrit comme jour férié légal
et chômé, et à la différence des autres jours fériés, il est
obligatoirement payé sans condition d’ancienneté ni de présence effective.
C’est cette exception juridique qui justifie une
attention particulière en paie. L’objectif de cet article est donc de rappeler
les règles à respecter, les cas autorisant le travail ce jour-là, les modalités
de majoration salariale, ainsi que les erreurs à éviter.
1. Le 1er mai : le seul jour férié obligatoirement chômé
et payé
En droit du travail français, le 1er mai occupe une place
singulière. C’est le seul jour férié dont le chômage est à la fois obligatoire
et rémunéré, quelle que soit la situation du salarié : contrat à durée
déterminée ou indéterminée, temps plein ou partiel, ancienneté faible ou nulle.
Cette règle est définie par l’article L.3133-4 du Code du
travail, qui dispose :
« Le 1er mai est jour férié et chômé. Le chômage de ce jour
ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés. »
- Il
est interdit de faire travailler un salarié ce jour-là, sauf cas
dérogatoires limitativement énumérés par la loi (voir partie suivante).
- Le
salarié perçoit son salaire comme s’il avait travaillé, sans condition
particulière.
- Ce
maintien de rémunération s’applique même si le salarié n’a pas trois mois
d’ancienneté, ou s’il a été embauché très récemment.
Cette règle distingue le 1er mai des autres jours fériés,
pour lesquels le maintien de la rémunération dépend :
- d’un
accord collectif ou d’une convention,
- ou
de conditions spécifiques comme l’ancienneté ou la présence effective au
travail la veille et le lendemain.
Le 1er mai est donc un droit universel pour les
salariés, que l’employeur ne peut ignorer ou contourner.
2. Travail exceptionnel le 1er mai : dans quels cas
est-il autorisé ?
Le principe est clair : le 1er mai doit être chômé
pour tous les salariés. Toutefois, le Code du travail prévoit une exception
stricte : seuls certains secteurs dont l’activité ne peut être
interrompue sont autorisés à faire travailler leurs salariés ce jour-là.
Ces dérogations concernent notamment :
- les
établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite),
- les
transports publics et privés,
- les
hôtels, restaurants et cafés,
- les
industries ou services fonctionnant en continu (centrales, raffineries,
sécurité…),
- les
entreprises de presse et de communication,
- les
services d’urgence ou d’astreinte.
Dans ces cas, le travail le 1er mai est légal, mais
il ne peut résulter d’une simple volonté de l’employeur : il doit être
justifié par la nécessité de maintenir l’activité.
A contrario, les conventions collectives, accords
d’entreprise ou contrats de travail ne peuvent jamais imposer le travail le 1er
mai, si l’activité n’entre pas dans le champ des dérogations légales. Une
telle disposition serait contraire à l’ordre public social.
Ainsi, toute entreprise ne relevant pas d’un secteur
autorisé ne peut faire travailler ses salariés ce jour-là, même avec leur
accord. En cas de non-respect, l’employeur s’expose à des sanctions (inspection
du travail, contentieux prud’homal, rappels de salaires avec majoration).
3. Majoration de salaire : une obligation légale
Lorsqu’un salarié travaille exceptionnellement le 1er mai,
il ne s’agit pas seulement de déroger à un jour férié chômé : le Code du
travail impose une majoration de salaire spécifique, qui ne dépend ni du
contrat de travail, ni de la convention collective.
Selon l’article L.3164-6 du Code du travail
(applicable par analogie pour tous les salariés), le travail effectué le 1er
mai donne droit à une rémunération doublée. Cela signifie que le salarié
perçoit :
- son
salaire habituel au titre du jour férié (comme s’il n’avait pas
travaillé),
- et
une deuxième fois ce même salaire au titre du travail effectué.
Autrement dit, le salarié est payé à 200 % pour les
heures travaillées le 1er mai, même en l’absence de stipulation
conventionnelle. Cette règle est d’ordre public : aucun accord collectif ne
peut prévoir un taux inférieur.
- Il
perçoit 105 € pour la journée, au titre du maintien de salaire,
- Plus
105 € de rémunération pour le travail effectué ce jour-là,
- Soit
210 € au total pour la journée.
Cette règle s’applique même si le salarié est à temps
partiel, en CDD ou intérimaire, dès lors qu’il travaille effectivement ce
jour-là dans un secteur autorisé.
Enfin, il ne faut pas confondre cette majoration avec celle
prévue pour les heures supplémentaires : la majoration du 1er mai est
automatique, dès la première heure, même si le salarié reste dans son
horaire contractuel.
4. Cas particuliers
Si les règles du 1er mai sont globalement uniformes,
certaines situations spécifiques soulèvent des questions pratiques pour les
employeurs et les gestionnaires de paie. Voici un tour d’horizon des cas
particuliers les plus fréquents.
a) Salariés à temps partiel
- En
arrêt maladie : si l'arrêt est indemnisé par la Sécurité sociale, aucune
rémunération complémentaire n’est due au titre du 1er mai.
- En
congé payé ou congé maternité/paternité : le 1er mai est alors intégré
au congé, sans incidence particulière, et reste payé.
c) Intérimaires, CDD et extras
d) Salariés absents injustifiés ou en grève
Le 1er mai étant encadré par des dispositions d’ordre
public, tout manquement à ces règles expose l’employeur à des sanctions.
a) Non-paiement du 1er mai chômé
- un
rappel de salaire avec effet rétroactif sur 3 ans (prescription),
- une
condamnation prud’homale pour exécution déloyale du contrat de travail.
b) Travail imposé en dehors des secteurs autorisés
- à un
redressement URSSAF (rémunération non conforme, absence de
majoration),
- à
une sanction pénale, en cas de manquements répétés,
- à
des dommages-intérêts devant le conseil de prud’hommes.
c) Absence de majoration en cas de travail effectif
d) Contrôle et contentieux
Pour éviter erreurs de paie, litiges ou contrôles, les
employeurs ont tout intérêt à anticiper et sécuriser la gestion du 1er mai.
Voici quelques recommandations concrètes.
a) Anticiper l’organisation du travail
- planifier
à l’avance les plannings du personnel,
- informer
clairement les salariés concernés de leur présence ce jour-là,
- veiller
à recueillir leur accord si nécessaire (même si l'accord ne remplace pas
la légalité).
b) Vérifier la convention collective
- majoration
supérieure à 100 % (125 %, 150 %, repos compensateur, etc.),
- jours
de récupération,
- modalités
spécifiques pour les temps partiels ou les CDD.
Il est donc important de ne pas se limiter au Code du
travail et de consulter le texte applicable à l’entreprise.
c) Paramétrer correctement les logiciels de paie
- paie
à 100 % s’il est chômé,
- double
paie en cas de travail effectif,
- gestion
adaptée pour les absents ou les salariés à temps partiel.
Une erreur d’automatisation peut entraîner des rappels de
salaire massifs si elle n’est pas détectée rapidement.
d) Informer et tracer
- rappel
du caractère chômé ou travaillé du jour,
- règles
de rémunération,
- dispositions
conventionnelles applicables.
Cette transparence permet d’éviter les malentendus et
renforce la confiance dans la gestion RH.
Le 1er mai n’est pas un jour férié comme les autres.
Obligatoirement chômé et payé, il s’impose à tous les employeurs, quels que
soient leur secteur ou leur taille. Les exceptions sont rares, strictement
encadrées, et ne dispensent jamais de la majoration salariale en cas de travail
effectif.
Pour les gestionnaires de paie et les dirigeants, respecter
ces règles est indispensable, non seulement pour rester en conformité avec le
droit du travail, mais aussi pour éviter les litiges, les rappels de salaires
et les tensions avec les salariés.
En résumé : le 1er mai ne s’improvise pas. Sa gestion
demande anticipation, rigueur et maîtrise des règles légales comme
conventionnelles. C’est à ce prix que l’on assure une paie juste, conforme et
sécurisée.
Mais au-delà de ses implications pratiques, le 1er mai reste
avant tout une date hautement symbolique. Consacré à la fête du Travail, il
rend hommage aux luttes sociales pour de meilleures conditions de travail.
Depuis la loi du 30 avril 1947, ce jour est inscrit comme jour férié légal
et chômé, et à la différence des autres jours fériés, il est
obligatoirement payé sans condition d’ancienneté ni de présence effective.
C’est cette exception juridique qui justifie une
attention particulière en paie. L’objectif de cet article est donc de rappeler
les règles à respecter, les cas autorisant le travail ce jour-là, les modalités
de majoration salariale, ainsi que les erreurs à éviter.
1. Le 1er mai : le seul jour férié obligatoirement chômé
et payé
En droit du travail français, le 1er mai occupe une place
singulière. C’est le seul jour férié dont le chômage est à la fois obligatoire
et rémunéré, quelle que soit la situation du salarié : contrat à durée
déterminée ou indéterminée, temps plein ou partiel, ancienneté faible ou nulle.
Cette règle est définie par l’article L.3133-4 du Code du
travail, qui dispose :
« Le 1er mai est jour férié et chômé. Le chômage de ce jour
ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés. »
Ce que cela implique pour l’employeur :
- Il
est interdit de faire travailler un salarié ce jour-là, sauf cas
dérogatoires limitativement énumérés par la loi (voir partie suivante).
- Le
salarié perçoit son salaire comme s’il avait travaillé, sans condition
particulière.
- Ce maintien de rémunération s’applique même si le salarié n’a pas trois mois d’ancienneté, ou s’il a été embauché très récemment.
Cette règle distingue le 1er mai des autres jours fériés,
pour lesquels le maintien de la rémunération dépend :
- d’un
accord collectif ou d’une convention,
- ou
de conditions spécifiques comme l’ancienneté ou la présence effective au
travail la veille et le lendemain.
Le 1er mai est donc un droit universel pour les
salariés, que l’employeur ne peut ignorer ou contourner.
2. Travail exceptionnel le 1er mai : dans quels cas
est-il autorisé ?
Le principe est clair : le 1er mai doit être chômé
pour tous les salariés. Toutefois, le Code du travail prévoit une exception
stricte : seuls certains secteurs dont l’activité ne peut être
interrompue sont autorisés à faire travailler leurs salariés ce jour-là.
Ces dérogations concernent notamment :
- les
établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite),
- les
transports publics et privés,
- les
hôtels, restaurants et cafés,
- les
industries ou services fonctionnant en continu (centrales, raffineries,
sécurité…),
- les
entreprises de presse et de communication,
- les
services d’urgence ou d’astreinte.
Dans ces cas, le travail le 1er mai est légal, mais
il ne peut résulter d’une simple volonté de l’employeur : il doit être
justifié par la nécessité de maintenir l’activité.
A contrario, les conventions collectives, accords
d’entreprise ou contrats de travail ne peuvent jamais imposer le travail le 1er
mai, si l’activité n’entre pas dans le champ des dérogations légales. Une
telle disposition serait contraire à l’ordre public social.
Ainsi, toute entreprise ne relevant pas d’un secteur
autorisé ne peut faire travailler ses salariés ce jour-là, même avec leur
accord. En cas de non-respect, l’employeur s’expose à des sanctions (inspection
du travail, contentieux prud’homal, rappels de salaires avec majoration).
3. Majoration de salaire : une obligation légale
Lorsqu’un salarié travaille exceptionnellement le 1er mai,
il ne s’agit pas seulement de déroger à un jour férié chômé : le Code du
travail impose une majoration de salaire spécifique, qui ne dépend ni du
contrat de travail, ni de la convention collective.
Selon l’article L.3164-6 du Code du travail
(applicable par analogie pour tous les salariés), le travail effectué le 1er
mai donne droit à une rémunération doublée. Cela signifie que le salarié
perçoit :
- son
salaire habituel au titre du jour férié (comme s’il n’avait pas
travaillé),
- et
une deuxième fois ce même salaire au titre du travail effectué.
Autrement dit, le salarié est payé à 200 % pour les
heures travaillées le 1er mai, même en l’absence de stipulation
conventionnelle. Cette règle est d’ordre public : aucun accord collectif ne
peut prévoir un taux inférieur.
Exemple :
Un salarié payé 15 € de l’heure travaille 7 heures le 1er
mai dans un hôtel :
- Il
perçoit 105 € pour la journée, au titre du maintien de salaire,
- Plus
105 € de rémunération pour le travail effectué ce jour-là,
- Soit
210 € au total pour la journée.
Cette règle s’applique même si le salarié est à temps
partiel, en CDD ou intérimaire, dès lors qu’il travaille effectivement ce
jour-là dans un secteur autorisé.
Enfin, il ne faut pas confondre cette majoration avec celle
prévue pour les heures supplémentaires : la majoration du 1er mai est
automatique, dès la première heure, même si le salarié reste dans son
horaire contractuel.
4. Cas particuliers
Si les règles du 1er mai sont globalement uniformes,
certaines situations spécifiques soulèvent des questions pratiques pour les
employeurs et les gestionnaires de paie. Voici un tour d’horizon des cas
particuliers les plus fréquents.
a) Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits
que les salariés à temps plein : si le 1er mai tombe un jour habituellement
travaillé selon leur planning, ils sont rémunérés normalement.
En revanche, si ce jour n’est pas habituellement travaillé (par exemple
un mercredi pour un salarié présent uniquement les lundis et vendredis), aucune
rémunération n’est due.
b) Salariés en arrêt maladie ou congé
- En
arrêt maladie : si l'arrêt est indemnisé par la Sécurité sociale, aucune
rémunération complémentaire n’est due au titre du 1er mai.
- En
congé payé ou congé maternité/paternité : le 1er mai est alors intégré
au congé, sans incidence particulière, et reste payé.
c) Intérimaires, CDD et extras
Tous les salariés, quel que soit leur type de contrat, bénéficient
du paiement du 1er mai s’il est chômé, dès lors qu’ils remplissent les
conditions classiques (jour normalement travaillé).
S’ils travaillent ce jour-là dans un secteur autorisé, la
majoration de 100 % s’applique également. L’employeur (ou l’agence
d’intérim) doit en assurer le versement.
d) Salariés absents injustifiés ou en grève
En cas d’absence non justifiée ou de grève le 1er mai, aucune
rémunération n’est due, puisque l’absence prive le salarié du bénéfice du
jour férié chômé et payé. Ce jour est alors décompté comme toute autre absence
non rémunérée.
6. Sanctions en cas de non-respect
Le 1er mai étant encadré par des dispositions d’ordre
public, tout manquement à ces règles expose l’employeur à des sanctions.
a) Non-paiement du 1er mai chômé
Si un salarié ne travaille pas ce jour-là, et que
l’employeur ne lui verse pas son salaire, il s’agit d’un manquement à
l’obligation légale de maintien de rémunération. Cela peut entraîner :
- un
rappel de salaire avec effet rétroactif sur 3 ans (prescription),
- une
condamnation prud’homale pour exécution déloyale du contrat de travail.
b) Travail imposé en dehors des secteurs autorisés
Faire travailler un salarié le 1er mai sans que l’activité
relève des cas dérogatoires prévus par la loi est illégal, même si le
salarié est volontaire. L’employeur s’expose alors :
- à un
redressement URSSAF (rémunération non conforme, absence de
majoration),
- à
une sanction pénale, en cas de manquements répétés,
- à
des dommages-intérêts devant le conseil de prud’hommes.
c) Absence de majoration en cas de travail effectif
Si un salarié travaille le 1er mai et qu’il n’est pas payé
double, l’entreprise doit verser un rappel de salaire équivalent à 100 % du
salaire de ce jour, avec intérêts de retard et éventuellement des
dommages-intérêts pour préjudice moral.
d) Contrôle et contentieux
L’inspection du travail peut intervenir en cas de
signalement, tout comme les représentants du personnel. En cas de litige, les
salariés disposent de trois ans pour agir.
6. Bonnes pratiques pour les employeurs
Pour éviter erreurs de paie, litiges ou contrôles, les
employeurs ont tout intérêt à anticiper et sécuriser la gestion du 1er mai.
Voici quelques recommandations concrètes.
a) Anticiper l’organisation du travail
Dans les secteurs autorisés à fonctionner le 1er mai
(restauration, transport, santé…), il est essentiel de :
- planifier
à l’avance les plannings du personnel,
- informer
clairement les salariés concernés de leur présence ce jour-là,
- veiller
à recueillir leur accord si nécessaire (même si l'accord ne remplace pas
la légalité).
b) Vérifier la convention collective
Certaines conventions collectives peuvent prévoir des
dispositions plus favorables :
- majoration
supérieure à 100 % (125 %, 150 %, repos compensateur, etc.),
- jours
de récupération,
- modalités
spécifiques pour les temps partiels ou les CDD.
Il est donc important de ne pas se limiter au Code du
travail et de consulter le texte applicable à l’entreprise.
c) Paramétrer correctement les logiciels de paie
Le 1er mai doit être géré comme un cas à part dans le
paramétrage :
- paie
à 100 % s’il est chômé,
- double
paie en cas de travail effectif,
- gestion
adaptée pour les absents ou les salariés à temps partiel.
Une erreur d’automatisation peut entraîner des rappels de
salaire massifs si elle n’est pas détectée rapidement.
d) Informer et tracer
Il est toujours utile de communiquer en amont avec les
salariés, notamment par note de service ou par email interne :
- rappel
du caractère chômé ou travaillé du jour,
- règles
de rémunération,
- dispositions
conventionnelles applicables.
Cette transparence permet d’éviter les malentendus et
renforce la confiance dans la gestion RH.
7. Conclusion
Le 1er mai n’est pas un jour férié comme les autres.
Obligatoirement chômé et payé, il s’impose à tous les employeurs, quels que
soient leur secteur ou leur taille. Les exceptions sont rares, strictement
encadrées, et ne dispensent jamais de la majoration salariale en cas de travail
effectif.
Pour les gestionnaires de paie et les dirigeants, respecter
ces règles est indispensable, non seulement pour rester en conformité avec le
droit du travail, mais aussi pour éviter les litiges, les rappels de salaires
et les tensions avec les salariés.
En résumé : le 1er mai ne s’improvise pas. Sa gestion
demande anticipation, rigueur et maîtrise des règles légales comme
conventionnelles. C’est à ce prix que l’on assure une paie juste, conforme et
sécurisée.